https://blogs.mediapart.fr/paulinep/blog/070618/la-medecine-sms-selon-macronbuzyn-si-vous-souffrez-tapez-1
« D'ici 2022, je souhaite porter la chirurgie ambulatoire à 70% »
annonçait Agnès Buzyn en octobre. Une déclaration accueillie à bras
ouverts par Le Figaro, qui va même plus loin au moment d’encenser le
« chatbot », un algorithme programmé pour envoyer des messages
post-opératoires aux patients, symptôme de l’invasion néolibérale dans
tous les champs de nos vies, y compris les plus intimes.
« D'ici 2022, je souhaite porter la médecine ambulatoire à 55% et la chirurgie ambulatoire à 70% » déclarait
Agnès Buzyn en octobre dernier. Des propos réaffirmés en février à
Eaubonne, qu’elle promeut en grande pompe en conférence et qu’elle
martèle sur Twitter en les accompagnant d’un hashtag « MieuxSoigner ».
Ni une ni deux,
Le Figaro s’est fait la remorque des réformes
santé du gouvernement, notamment dans un article daté du 9 avril et
intitulé « Hôpitaux : le gouvernement veut accélérer le "virage
ambulatoire" ». Où l’on peut lire dès l’introduction :
« Entrer à l'hôpital le matin, être opéré, sortir le soir… et
recevoir le lendemain le SMS d'un robot - on dit « chatbot » - qui prend
des nouvelles ! Cette séquence n'a rien à voir avec de la
science-fiction mais est désormais une réalité pour les patients de
l'AP-HP, qui s'est équipée d'un algorithme conçu par la société
Calmedica, déjà utilisé par une centaine d'hôpitaux publics et privés en
France. Loin d'y voir une forme de déshumanisation, patients et
soignants sont au contraire unanimes sur les bienfaits de ce service. »
« Unanimes sur les bienfaits de ce service » ?! Si c’est une
plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Sinon, c’est une honte !
Car c’est une nouvelle fois au mépris de ce qu’endurent patients et
travailleurs – et en leur nom – que viennent pérorer ministres et
certains journalistes.
Une intrusion robotique dans l’intimité
Si de nombreux témoignages glaçants concernant l’hôpital et son état
de crise ont vu le jour, je voudrais donner le mien sur ce sujet précis.
Il y a quelques mois, je subissais une opération gynécologique visant à
retirer des lésions pré-cancéreuses du col de l’utérus. La conisation
est une opération que subissent de nombreuses femmes et qui est prévue
en ambulatoire. Voici les messages – dont
Le Figaro parle comme d’un progrès – que j’ai reçus trois jours (trois !) après cette chirurgie ambulatoire, dont je chanterai les
« bienfaits » ensuite :
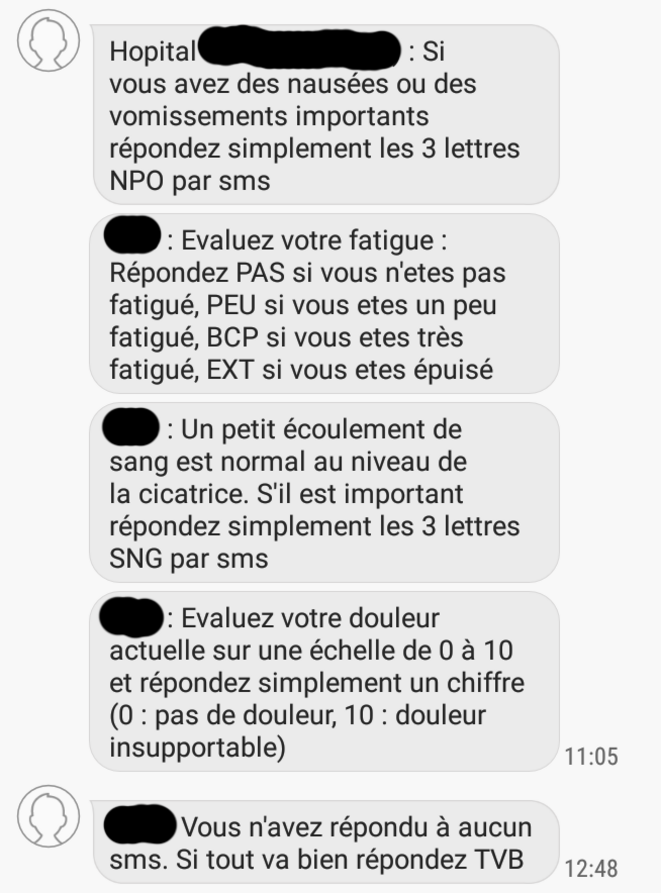
Déshumanisation était pourtant bien le mot ! Recevoir ces messages
trois jours après une telle opération, ça a été en tant que femme et
patiente, extrêmement douloureux et humiliant. Aucune réponse n’était
possible. Un choc entre sidération, tristesse et colère. Une intrusion
robotique dans l’intimité, un crachat en pleine figure. Ces messages, je
sais que bien d’autres femmes les ont reçus et que d’autres
continueront d’en recevoir. D’où ce témoignage, comme un encouragement
collectif à témoigner. Car comme le précise l’auteure de l’article
rompue aux louanges de technologies orweliennes, des centaines
d’hôpitaux se sont équipés de cet algorithme. La start-up Calmedica,
convertie en relais des politiques de « dégraissage » du public, a
développé cet outil en
« remportant un appel d'offres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) »[1].
Chaque jour un peu plus, on se demande « jusqu’où ira-t-on ? » Jusqu’où
rogneront-ils dans la décence et le bien-être des personnes au nom de
la réduction des dépenses et du management ? Si malaise, devrons-nous
bientôt envoyer MAL par SMS ? Si infarctus, FIN ?
Robotiser des actions médicales qui étaient auparavant prises en
charge par des gens en chair et en os : pour sûr, quel progrès ! Car
pourquoi de tels messages sont une violence ? Parce qu’ils bâillonnent
des échanges humains pourtant indispensables quand on est confronté à la
maladie. Des échanges qui ne rentrent pas dans leurs logiciels
comptables, mais qui rendent nos vies un peu moins pénibles et qui
garantissent un meilleur suivi. Parce qu’on est sommé de répondre en
trois lettres, mais qu’une maladie gynécologique, pour une femme,
nécessite généralement davantage que trois lettres par SMS ! En ce sens,
c’est une double violence, liée d’abord au tabou qui règne encore sur
certaines pathologies sexuelles qu’elles sont les seules à subir, et au
mépris avec lequel ces start-ups prévoient de les accompagner dans les
soins. De plus, ce principe d’auto-évaluation rend le patient
responsable de diagnostics qu’il est pourtant incapable de poser à
défaut d’avoir une formation médicale adéquate. Un principe qui est en
outre une porte ouverte à l’auto-censure : on se dit que même si on a
mal, ça ne mérite pas de déranger ou d’appeler le personnel médical et
que si un tel système est en place, c’est que l’on ne risque finalement
pas notre vie… Ne pas oser solliciter les soignants : c’est déjà ce que
se disent beaucoup de patients à l’hôpital,
a fortiori quand ils ont conscience que les personnels sont débordés.
L’ambulatoire, un « plus » pour patients et personnels ?
Par ailleurs, la ministre de la santé n’a de cesse de claironner que la chirurgie ambulatoire est un
« plus pour les patients, les praticiens et les établissements » : permettons-lui
également de douter et faisons-la ravaler ces propos et insultes :
soutenons et luttons aux côtés des personnels de santé partout en grève !
Car « l’ambulatoire » a des conséquences très concrètes en terme
d’organisation du travail pour les salariés et de prise en charge des
malades. A l’hôpital, nous étions « à la chaîne ». Une blouse, des
chaussons, une culotte. C’est là. Vous sortez après la cabine, et vous
allez vous asseoir. Une jeune fille est juste derrière. Elle n’a pas
l’air très bien non plus. De toute façon, on ne comprend rien car
personne ne nous a rien expliqué. Parce que tout le monde court et que
personne n’a le temps. Nom, numéro de sécu, dossier. La chaise roulante
et enfin, la table d’opération.
Au réveil, on m’amène dans une chambre. Une petite boîte où je m’installe sur un lit.
« Il faut uriner » me
dit-on. C’est par là. Je viens tout juste de me réveiller, les jambes
chancellent, brouillard. Personne pour m’accompagner, je me déplace au
hasard. On m’apporte un café et une tartine. Une amie qui travaille à
l’hôpital m’a dit que c’était complètement irresponsable d’apporter un
café à quelqu’un qui sort tout juste d’une anesthésie générale. Peu
importe. L’infirmière n’était peut-être même pas au courant. Vingt
minutes dans cette petite salle et dehors, il faut la libérer fissa pour
le patient suivant. C’est ça l’ambulatoire. C’est ça, sauf que la tête
tourne. Mais tant pis. Tu n’es pas au bord du gouffre, c’est donc que ça
doit pouvoir tenir. J’ai été mise en salle d’attente. Assise. J’y suis
restée plus de deux heures. Deux heures assise sans que personne ne soit
venu me demander ce que je pouvais bien faire encore là, la tête
droguée et incapable d’entreprendre quoi que ce soit. Un malentendu avec
la salle d’attente principale où m’attendait mon copain, à qui on n’a
rien expliqué non plus. Parce que l’ambulatoire, c’est ça. Ça va
tellement vite qu’il est impossible de coordonner les lieux, les
espaces, et encore moins les personnels et les personnes.
Si l’ambulatoire est un « virage », il est donc un virage « en
arrière toute » comme en témoignent de nombreux personnels. Augmenter le
taux d’ambulatoire, comme le souhaite la ministre, signifie
nécessairement élargir l’éventail et assouplir les critères des patients
qui y seront soumis, alors qu’on sait déjà que cette pratique a pour
conséquence une détérioration des conditions du suivi pré et post
opératoire, pour les patients, comme pour les soignants. Couplée à
l’asphyxie générale de l’hôpital public et aux baisses de
moyens/personnels à marche forcée, cette démarche est effrayante.
Ce témoignage, ce n’est pas que le mien. La souffrance des patients
est dite quotidiennement, par eux-mêmes, mais également par les
personnels qui disent la nôtre en plus de la leur, qui n’en peuvent
plus, qui asphyxient et se rendent compte qu’ils ne peuvent plus exercer
dignement leur métier. Ces méthodes les impactent évidemment au premier
chef : eux, c’est tous les jours qu’ils les voient, les subissent et
les infligent malgré eux. De nombreux reportages l’ont tragiquement
montré : se rendre compte qu’on fait du mal, même si on ne l’a pas
voulu. Parce que ça presse, et qu’on ne peut pas faire autrement. S’en
rendre compte tous les jours un peu plus. En discuter avec les
collègues. Et réaliser encore un peu plus. Jusqu’à ce que ce ne soit
plus possible. Jusqu’à ce que ça craque. Et ensuite ? La suite, on la
connaît bien, des journalistes sérieux l’ont montrée : mal être au
travail, honte, burn-out, suicides. Des personnels l’ont dénoncée et se
mobilisent tous les jours. Des familles entières l’ont subies dans leur
chair.
Normaliser la souffrance à tous les étages
Partout, les « visions » managériales du gouvernement Macron
méprisent le sens même du service public et excluent du travail le
moindre temps qu’il ne jugent pas « utile » ou « rentable ». Ces
logiques nous forcent à nous accoutumer à la froideur et au cynisme de
tous les procédés développés pour les servir. C’est non ! Et qu’il soit
permis de douter, au grand dam des certitudes du
Figaro, que les
travailleuses et les travailleurs de la santé estiment, tant pour
eux-mêmes et leurs conditions de travail que pour les patients, que ces
messages post-opératoires soient un
« bienfait ». Pour sûr, cette
pratique les aura déchargés d’une tâche, mais toujours au prix d’une
régression : les infirmier.e.s ont ainsi gagné quelques minutes dans un
agenda surmené, un marathon journalier qui ne cesse d’empirer ; la
qualité des soins a quant à elle fait un nouveau pas en arrière. Voilà
le désert que reflètent et promettent les « visions » gouvernementales
sur la santé.
Un gouvernement qui persiste à détruire nos services publics. Le
résultat ? Normaliser la souffrance à tous les étages, contraindre à
endosser toujours plus. En fin de compte, nous perdons chaque jour
conscience des droits que nous avons. Des raisonnements du type : « bon…
c’est vrai que ça, ça n’est peut-être pas forcément utile » nous
conduisent à rogner sur tout un tas de choses, chaque jour un peu plus.
Nous nivelons par le bas au lieu de penser par le haut aux véritables
émancipations que pourraient nous procurer ces sociétés dites
« développées » et aux moyens pour les mettre en œuvre. On nous force à
nous habituer au « toujours moins », aux traitements différenciés,
socialement discriminants et, en définitive, au « toujours pire ». Pour
quoi faire ? Pour que quand viennent les catastrophes, dont beaucoup
sont déjà là, nous regardions leurs organisateurs se regarder entre eux
les yeux mouillés en disant : « je l’avais pas vu venir » ?
Alors merci et courage à toutes les travailleuses et tous les
travailleurs de la santé – comme à tous les autres – partout en lutte,
en grève, et souvent face au silence de leurs directions et des médias.
Merci de vous battre comme vous le faites partout, pour nous, chaque
jour. Colère toute partagée, solidarité sans borne, espoir sans faille
qu’on les mette enfin à terre.
Pauline P.
[1] Selon l’article
« La start-up Calmedica équipe l'AP-HP d'un outil de suivi à domicile des patients » du site TICsante.com. L’auteur, béat devant ce qu’il considère être une innovation, porte aux nues
« l’efficacité » de ce robot conversationnel. L’article note que la start-up,
« fondée
en 2013 par Corinne Segalen et Alexis Hernot, diplômé de l'école
Polytechnique et de l'Institut européen d'administration des affaires
(Insead), équipe déjà plusieurs établissements de santé comme le CHU de
Rennes, le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph (GHPSJ), le CH d'Agen
et la polyclinique de Gentilly à Nancy (groupe Elsan). »

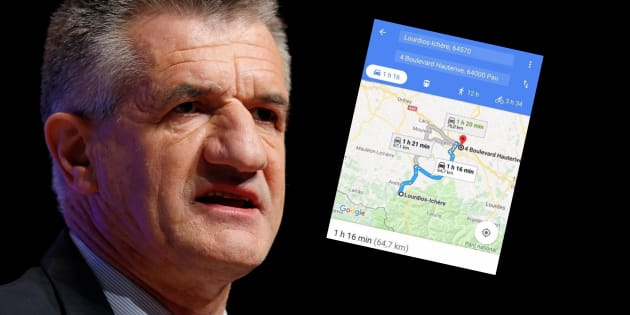










 Gare de Loudéac
Gare de Loudéac










